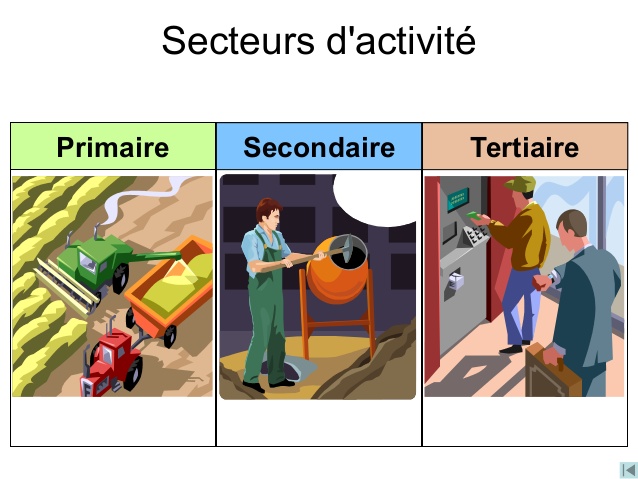Introduction
Depuis son indépendance,
la Côte d’Ivoire a accordé une place de choix à chaque secteur d’activités dans
sa stratégie de développement économique.
D'une façon générale, on distingue 3 secteurs
d’activités économiques : le secteur primaire, le secteur secondaire
et le secteur tertiaire.
L’étude de ces différents secteurs d’activités permet d’apprécier le niveau de
développement du pays et de mesurer leur poids dans l’économie de la Côte
d’Ivoire.
II - LE SECTEUR PRIMAIRE.
La Côte
d'lvoire est souvent présentée, dans un continent où les conditions de vie
quotidienne se sont détériorées depuis des années comme « l’Afrique heureuse »,
et cela grâce à son secteur primaire, plus particulièrement son agriculture.
Ce secteur comprend, en outre, l’élevage, la pêche et l’exploitation des
ressources forestières.
1-L'exploitation forestière
L'exploitation
forestière a fortement contribué à l’essor économique du pays.
En effet, pendant la période coloniale et dans les premières années qui ont
suivi l’indépendance, les premiers échanges commerciaux avec l’extérieur ont démarré
avec l‘exportation du bois en grume, principalement I'acajou bassame.
Aujourd'hui, malgré le recul de l’activité forestière, l’exportation des
produits procure d'importantes recettes. Les statistiques récentes de ce
secteur ne sont pas disponibles.
En plus des recettes qu'elle procure au pays, l'exploitation des ressources forestières
offre de nombreux emplois.
L'exploitation forestière porte sur:
.des
essences d’intérêt primordial: ce sont l'acajou, le sipo, le tiama, le kotibé,
l'avodir l'assamela, la samba, le framiré, le niangon, le bété, l'iroko et des
essences d’intérêt secondaire: la lingue, le fromager, le dabema.
2-L'agriculture
Actuellement,
principal pilier de l’économie ivoirienne, l’agriculture a pris le pas sur l’exploitation
forestière après l’indépendance. Estimé à plus de 70% des exportations
ivoiriennes (moyenne de 1990 à 1997), le secteur agricole est la principale
source de devises de la Côte d'lvoire. II faut noter cependant que de tous les
produits agricoles, le café et surtout le cacao qui sont des cultures de la
zone forestière restent aujourd'hui encore des filières clés de l’économie
ivoirienne. Ils représentent à eux tous seuls plus de 40% des exportations du
pays. Ces deux produits représentent 25% du PIB et occupent 21,3% de la
population active en 2003. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial
de cacao avec 1 388 4891 tonnes, soit plus de 40% de l'offre mondiale et le 7è
producteur mondial de café avec 250 8661 tonnes en 2003/04.
C'est sans aucun doute que certaines personnes affirment que la Côte d'lvoire
est un don du café et du cacao. Tout comme le cacao et le café, le palmier à
huile, la banane, la noix de cola, l ‘hévéa, l‘ananas, le coton, l‘anacarde,...
rapportent aussi d'énormes devises au pays.
En somme, le secteur primaire est le moteur de la croissance de la Côte
d'lvoire. Il représente 37% du PIB et occupe la majeure partie de la population,
soit près de 61,3% de la population active. Il représente en outre 52,64% des
recettes globales des exportations ivoiriennes en 2003. Ainsi, depuis les années
1980, la chute des prix des matières premières agricoles sur le marché international
a gravement influé sur l‘économie ivoirienne.
3-L’élevage et la pêche
a) L’élevage
En comparaison avec les pays sahéliens, la Côte d'lvoire n'est pas un pays où il existe une tradition d’élevage. C'est tout naturellement que dès l ‘indépendance du pays, le gouvernement va accorder une place importante dans ses programmes de développement à l’élevage. En plus d'encourager la transhumance du bétail du Mali et du Burkina Faso vers le sud, le gouvernement va inciter les nationaux à se lancer dans l’élevage. Cette politique concerne non seulement les bovins, mais également les caprins, les ovins, les porcins ainsi que la volaille.

Le cheptel national (2000 à 2005) en milliers de têtes
L’élevage
contribue pour 2% au PIB total et pour 4,5% au PIB agricole.
b) La pêche
Le poisson
est la première protéine animale consommée dans le pays. Il est fourni soit par
la pêche artisanale soit par la pèche industrielle.
Le secteur industriel débarque en moyenne 30 000 tonnes par an, tandis que la pêche
artisanale produit près de 50 000 tonnes. La consommation est de l‘ordre de 300
000 tonnes. La pêche nationale ne fournit que 26,67% du poisson consommé en Côte
d'lvoire.
La contribution de la pêche au PIB total est 0,8% soit 54,6 milliards F CFA en
2000.
La pêche artisanale est très active dans le Sud du pays; mais avec
la construction des barrages hydroélectriques et les lacs, elle se
déplace vers l‘intérieur du pays. La pêche artisanale emploie des méthodes
archaïques (utilisation de ligne de fond, de senne de rivage et d’épervier).
Les activités de pêche industrielle sont toutes concentrées dans le port
d'Abidjan où est basée la flotte de sardiniers et de chalutiers. La pêche
industrielle est dominée par le thon. Abidjan est le premier port thonier
d'Afrique.
II - LE SECTEUR SECONDAIRE
Au lendemain
de l’indépendance, la Côte d'lvoire était essentiellement agricole. Soucieuse
de son développement économique, elle a accordé une priorité à l’activité
industrielle.
1-Les potentialités minières et énergétiques de la Côte d'lvoire.
a) Les ressources minières
La Côte d'lvoire n'est pas entièrement dépourvue de ressources minières. La prospection du sous-sol a révélé une variété de ces ressources. II s'agit:
- du manganèse localisé a Guitry (précisément dans le village de Lauzoua) en exploitation actuellement et dans la région d'Odienne;
- du diamant à Tortya et à Séguéla
- de l ‘or à Ity, dans le bassin de la Lobo et à
- Afenna après d'Aboisso.
- Des indices sous forme alluvionnaire sont principalement notés dans les régions d'Agboville, Issia, Tanda, Hiré, Toumodi et dans le Yaouré (en exploitation artisanale);
- du fer découvert à Odienne, Bangolo, dans le mont Nimba et à San Pedro ;
- du nickel, chrome, cobalt a Marabadiassa dans le département de Béoumi;
- de la bauxite à Divo, Sinfra, Bouaflé et Bongouanou.
D'autres prospections entreprises depuis quelques années par la SODEMI ont abouti à la découverte de minerais lithinifères, de columbium, de tantalité, de pierres ornementales dans les régions d'Agboville, Sassandra, Gagnoa, Alépé et Zuénoula.
b)
Les ressources énergétiques
• Les hydrocarbures
Si le sous-sol ivoirien n'a pas révélé la présence de charbon, les recherches
de pétrole ont abouti à la découverte de gisements importants de pétrole et de
gaz naturel au large des côtes de Jacquéville (en exploitation), de
Grand-Bassam et San Pedro. Ce sont: Baobab, Acajou, Bahia, Bélier, Espoir,
Lion, Panthère et Foxtrot.
La production pétrolière ivoirienne a atteint le niveau de 80 000 barils/jour
depuis août 2005 avec la mise en production du champ baobab. La consommation
ivoirienne se chiffre à 25 000 barils/jour.
L'électricité
L'électricité est fournie par les centrales thermiques de Vridi, d'Azito et les différents barrages hydroélectriques que sont Ayamé I et II sur la Bia ; Kossou et Taabo sur le Bandama et Buyo sur le Sassandra.
A ce jour, environ 65% de l'électricité du pays provient des centrales thermiques.
2-Les activités industrielles et leur répartition géographique
a)
La répartition spatiale du secteur industriel
Abidjan concentre plus de 70% des entreprises industrielles, emploie 50% des travailleurs et réalise 65% du chiffre d'affaires.
Bouaké, le centre
industriel ne regroupe que 5% des industries, 8% du chiffre d'affaires et 11%
des travailleurs avant la guerre.
Aujourd'hui, beaucoup d'unités industrielles ont fermé leurs portes dans la
ville.
Dans le reste du pays sont éparpillées les industries alimentaires, les 2/3 des
industries du bois, la totalité des industries extractives
(mines, carrières) et quelques usines textiles.
Les facteurs de cette inégale répartition sont:
Abidjan est un port dynamique, regroupe les infrastructures de communication et
les capitaux, une main d’œuvre marché de consommation important.
b)
Les principaux types d'industries
On peut
distinguer deux grandes catégories d'industries :
• Les industries de base
Elles
comprennent les industries minières ou extractives et les industries de la
transformation.
Les industries de première transformation fabriquent des produits semi-finis à
partir des produits bruts miniers, agricoles ou de bois.
Ex: les usines d'égrenage de coton, la SIR, les cimenteries, les scieries,...
Ces produits semi-finis sont destinés aux usines de transformation.
• Les industries de transformation
Elles utilisent les matières 1ères ou les produits semi-finis pour fabriquer des produits finis et
des objets directement utilisables. Ce sont par exemple les manufactures de tabac, les industries agroalimentaires, les usines textiles.
c)Les
activités industrielles
On peut
citer pêle-mêle les industries agroalimentaires (huileries, savonneries,...),
textiles, chimiques, les cimenteries, les constructions mécaniques et
électriques, les usines de montage automobile, les industries du cuir et des
chaussures, du verre,...
L'importance
du secteur industriel dans I ‘économie
a)
En dépit de la faiblesse de ressources minières, la Cote d'lvoire connait
depuis son indépendance un développement industriel important. Avant la crise
militaro-politique, Industrie ivoirienne fournissait 23% du PIB et employait
plus de 350 000 travailleurs.
Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises industrielles ont soit fermé leurs portes
soit délocalisé leurs activités dans les pays voisins
III - LE SECTEUR TERTIAIRE
Le secteur tertiaire est un secteur économique dont l’activité consiste à produire des biens immateriels ou des services.
Situe en
amont et en aval des autres secteurs, le secteur tertiaire conditionne la
croissance écononnique de la Cote d'lvoire. Il représente
38,1% du P.I.B et emploie 31% de la population active en 2005. Ce secteur
regroupe les services, les échanges, les transports, le tourisme
et les activités dites informelles.
1-Les services et les activités informelles.
a)
Les services
Ce sont des
activités économiques qui ne produisent pas directement de biens. Ils comprennent
les banques, les assurances, la bourse des valeurs, les transports, la
recherche, l’enseignement ou le conseil, etc.
Les transports sont l’ensemble des moyens permettant de transporter des
personnes ou des marchandises. Les transports dans leur ensemble connaissent
une activité soutenue. L'excellence des infrastructures de transport dans le
temps fait de cette activité le moteur du désenveloppent de la Côte d'lvoire.
Les banques, les assurances et la bourse des valeurs d'Abidjan devenue BRVM
recueillent l’épargne publique et financent des entreprises tant privées que
publiques ou des projets de désenveloppent.
b)
Les activités informelles
Elles
concernent les activités économiques non soumises aux normes d'organisation et
de gestion. Les activités informelles en Côte d'lvoire représentent une mise
d'emplois. Actuellement, elles viennent en 2è position, après l’agriculture,
pour l’emploi en occupant plus de 1,5 millions de travailleurs en ces temps de
crise ou les entreprises ferment leurs portes. Elles représentaient 12 à 20% du
P.LB avant la guerre.
2-Les échanges
a) Le commerce intérieur
Pendant toute la période coloniale et une décennie après l‘indépendance, les échanges au sein du pays échappaient pour une large part aux Ivoiriens. Dans le but de moderniser et d'ivoiriser le circuit de distribution, I'Etat a mis en place, dans les années 1970, le Programme d'Action Commerciale (PAC). Mais en 1980, des problèmes de gestion ont obligé l’Etat à mettre fin à ce programme. Néanmoins, il a poussé les Ivoiriens à s'intéresser au commerce jusqu'alors aux mains des étrangers.
Les produits
manufactures et agricoles et des productions animales sont connnnercialisés sur
les marchés urbains et ruraux ou par le biais d'une multitude de magasins et
d'étals.
Toutefois, la distribution des produits agricoles et les productions animales
rencontre des difficultés énormes :
- le manque de structures adéquates de conservation
- les intermédiaires véreux entre les producteurs et les consommateurs.
Pour réduire ces pertes et éliminer les intermédiaires, l’Etat a mis en place de grands marchés ruraux et urbains. Il a décidé de responsabiliser davantage les producteurs en leur confiant la collecte primaire et son acheminement vers les centres d'achat.
L’Etat encadre
aussi les petits commerçants par le biais du programme national d'assistance
aux commerçants ivoiriens.
Le secteur prive joue un rôle déterminant dans la commercialisation des
productions animales.
b) Le
commerce extérieur
II est
essentiel dans le développement économique du pays. Son évolution depuis l’indépendance
est particulièrement significative. Si la
balance commerciale est restée excédentaire jusqu’à 1980, la chute des prix des
matières 1ères agricoles sur le marché international a gravement influé sur l’économie
ivoirienne. Alors que les exportations diminuent, les importations quant à
elles, ne cessent de croître.
Les importations portent pour l’essentiel sur les produits manufacturés alors que les exportations reposent essentiellement sur le couple café- cacao et le bois. Exemple: en 2005, le total des exportations s’élève à 4 060,1 milliards de francs CPA contre 3098 milliards.
Le pays commerce
principalement avec l’Europe occidentale notamment la France qui est son
partenaire privilégié. II cherche aujourd'hui à diversifier ses partenaires et
commercer surtout avec les pays du tiers monde (Inde, Chine, CEDEAO,...).
3-Les infrastructures de transport
Facteur primordial du développement des échanges (de personnes, de marchandises, d'information), le système de transport et de communication constitue une condition de développement économique et social d'un pays. Pour cette raison, la Côte d'lvoire a développé une infrastructure moderne.
a)
Le chemin de fer
II se réduit à la seule ligne Abidjan-Ouagadougou, longue de 1173 km dont 627 km sur le territoire ivoirien. II contribue au renforcement des relations économiques entre le Burkina et la Côte d'lvoire.
b)
Le réseau routier
La Côte
d'lvoire possède le meilleur réseau routier de l’Afrique au Sud du Sahara. En
1990, le réseau routier ivoirien était estimé à 68 200 km dont 5 200 km
asphaltes et 63 000 km de routes carrossables.
Aujourd'hui, il est estimé à 82 000 km dont 6 500 km bitumes et 75 000 km de
routes carrossables. La modernisation du réseau routier s'est accompagnée du développement
important et rapide du parc automobile.
c) Les ports
Au plan de l’équipement portuaire, la Côte d'lvoire dispose de deux ports en eau profonde :
— le port
d'Abidjan ouvert en 1951 est le premier port d'Afrique francophone par ses
installations ultramodernes. C'est aussi un port de transit pour les pays
enclaves de l’Afrique de I ‘Ouest.
— le port de San Pedro ouvert en 1971 permet l’évacuation des productions du
Sud-Ouest ivoirien. Le volume du trafic du port d'Abidjan et celui de San Pedro
est respectivement de 18,6 millions de tonnes et 1,5 millions de tonnes en 2005.
c)
Le transport aérien et lagunaire
La Côte
d'lvoire dispose de 2 aéroports internationaux et d'une quinzaine d’aérodromes.
Les lignes intérieures autrefois assurées par Air ivoire avaient été concédées
à une compagnie privée Air Continental sont aujourd'hui desservies par la
nouvelle Air Ivoire, compagnie privée.
Les fleuves dans le pays ne sont pas navigables; les lagunes reliées entre
elles par des canaux (3) offrent, par contre, un remarquable réseau de 300 km
depuis la frontière du Ghana jusqu’à Fresco. Le trafic concerne le transport
des passagers et des produits agricoles.
4-Le tourisme en Côte d'lvoire
Limitée avant l’indépendance à l’accueil des Européens rendant visite à leur famille expatriée, ou à celui des passionnés de la chasse au gros gibier, l’économie touristique est en fait née en 1961 avec la création de la compagnie multinationale Air Afrique et la construction en 1963, de l‘hôtel Ivoire à Abidjan. Pourtant, le pays dispose de nombreux atouts surtout naturels. Une politique dynamique devrait contribuer à le mettre en valeur.
a) Les atouts touristiques de la Côte d'lvoire.
La Côte d’Ivoire dispose de sites merveilleux, de monuments et de réceptifs hôtels pour le développement du tourisme.
a-1) Les atouts naturels
Le pays possède de nombreux atouts naturels au nombre desquels :
- des plages à sable fin pour le tourisme balnéaire;
- des paysages naturels riches en faune et en flore;
- les cascades
- etc.,
a -2) Les monuments
Les maisons coloniales dans les villes du littoral ivoirien, les mosquées pré coloniales de Kong et de Bondoukou, des chefs d’œuvre architecturaux comme la Basilique notre Dame de la Paix, les grandes écoles et la Fondation F.H.B de Yamoussoukro, la cathédrale saint Paul, la mosquée du Plateau et le Palais de la culture constituent des attraits touristiques.
a-3) Les atouts culturels et traditionnels
Ils sont constitués des tisserands de Waraniène, des forgerons de Koni à Korhogo, les ponts des lianes, les masques et danses Dan et Gouro, l’Abissa, la fête du Dipri de Gomon,...
a-4) Les réceptifs hôteliers
Ce sont les villages de vacances, les motels, les hôtels assurant la restauration et l’hébergement des touristes.
b) Le tourisme, une activité prometteuse.
b-1) Le tourisme, une activité d’intérêt certain.
Le tourisme est une activité économique d'un intérêt certain tant par les emplois qu'il crée et les activités qu'il induit que par les devises qu'il procure.
Le tourisme
participait à 1,5% au PIB. Il pourrait être une importante source de devises:
déjà 20 milliards de francs CFA en 1991. II offrait 15 000 emplois à la même
année. II contribue au désenveloppent d'autres activités économiques (activité
de production, échanges commerciaux, transport, artisanat,...).
Le tourisme
forme à la connaissance de la géographie et de l’histoire des régions et des
peuples visités; c'est un instrument efficace d’intégration régionale et de
rapprochement des peuples. II est une source de loisirs et de détente pour une
bonne reprise du travail.
Dépendant, avec le conflit armé qui a frappé le pays depuis 2002, le
secteur du tourisme et de l’hostellerie est certainement l’un des plus sinistrés.
b-2) Les actions de promotion
L'Etat
ivoirien, conscient du rôle que peut jouer le tourisme dans le développement du
pays, a créé depuis 1970 un ministère du Tourisme
pour mieux organiser et rentabiliser cette activité. La promotion de la
destination Côte d'lvoire est confiée à Côte d’Ivoire Tourisme qui a remplacé
l’Office Ivoirien du Tourisme et de l’Hôtellerie depuis 2002. Ses actions de
promotion se situent à quatre(4) niveaux :
- publicité agressive dans la presse et affichages destinés au grand public;
- confection d'outils promotionnels: prospectus, brochures, dépliants, guides,... plusieurs langues;
- campagne spécifique de prénotion pour les congrès et voyages d'affaires;
- ouverture de nouvelles délégations du tourisme en Europe notamment en Europe de l’Est.
Avec ces actions, il s'agit de vendre mieux la Côte d'lvoire et la positionner solidement pour imposer son image de merveilles touristiques au public des pays les plus intéressés (par la destination C.I). Ainsi, le tourisme, puissant instrument de développement économique particulièrement efficace, pourrait jouer pleinement son rôle en Côte d'lvoire si les difficultés rencontrées sont résolues.
Le tourisme constitue une activité importante. Le pays pourrait mieux profiter de son image de marque si il parvenait à traduire par des actes concrets les objectifs et les actions promotionnelles définis pour résoudre les difficultés dans ce domaine d’activité. Sa redynamisation par des actions vigoureuses de cette activité donnera un souffle nouveau l'économie ivoirienne.
Conclusion
Malgré les efforts de l’Etat ivoirien pour développer les secteurs secondaire et tertiaire, le secteur primaire et plus particulièrement l’agriculture demeure la mamelle de l'économie de la Côte d'Ivoire. Nonobstant sa relative prospérité économique dans la sous-région, la Côte d’Ivoire ne saurait cacher les problèmes qu’elle rencontre.
Sources : https://sites.google.com (histoire-géo numéro 8)